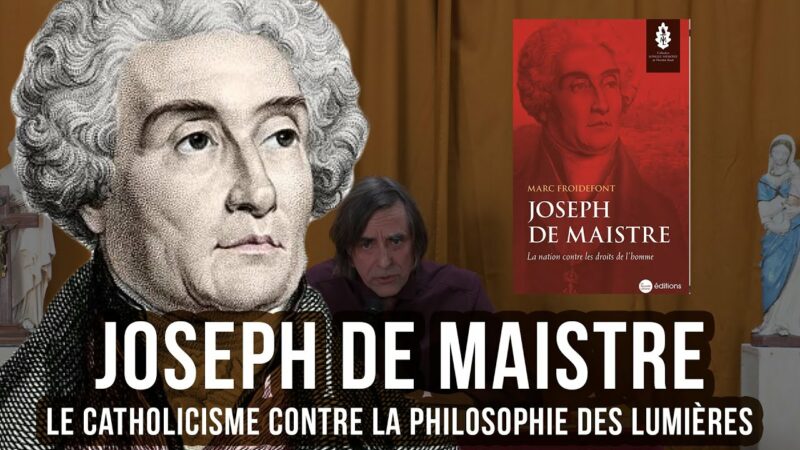Portrait de Dom Guéranger

Les portraits que nous peignons sont-ils ressemblants ? Telle est la question que nous nous posons douloureusement en abordant celui de D. Guéranger, dont un grand artiste si bien interprété naguère la physionomie profond définie, les yeux pétillants de vie, et cette expression batailleuse et souriante qu’on ne saurait jamais oublier. Mais hélas ! nous qui ne peignons qu’avec des mots et qui nous attachons à reproduire uniquement des âmes, pouvons-nous avoir la prétention de rendre la vie à cette figure qui fut si énergiquement vivante ? Il est une légende qui fait peur, et qu’un romancier contemporain a prise pour le sujet d’un de ses contes les plus étranges.
C’est l’histoire de ce peintre qui fait un jour le portrait d’un être aimé, et qui transporte réellement la vie sur sa toile en l’enlevant à son modèle. Quand le portrait est achevé, il est vivant… mais l’être aimé est mort. Que ne pouvons-nous donner la vie à nos tableaux, en la laissant à ceux que nous peignons ! Mais ce serait le chef-d’œuvre de l’art, et peu de peintres atteignent cette trop rare perfection.
Néanmoins, il nous a paru qu’il ne serait peut-être pas inutile d’essayer ce portrait, afin de remettre en la mémoire des catholiques de notre temps le grand rôle qu’a joué, durant nos dernières luttes, un de nos pères spirituels, de nos chefs, de nos maîtres.
En ce moment croit une nouvelle génération chrétienne, une jeunesse qui aimerait à connaître ceux à qui elle doit quelque reconnaissance. D’autres luttes peut-être sont imminentes, et il n’est pas sans intérêt, j’allais dire sans actualité, de décrire la physionomie des anciennes batailles et la figure des vieux combattants. C’est ce qui attachera quelque intérêt à l’esquisse que nous allons tracer à grands traits, et par laquelle nous avons le dessein de faire connaître une des plus grandes figures de l’Église en France.
On ne saurait témoigner trop de gratitude à ceux qui, les premiers, entrent dans une voie nouvelle. À ces téméraires il faut beaucoup pardonner. Ils n’ont pas toujours le temps d’achever leur œuvre, et les labeurs de leur initiative nuisent parfois à la perfection de leur travail. Quand paruit, en 1840, le premier volume des Institutions liturgiques, combien de personnes, mêmes ecclésiastiques, s’occupaient en France de science liturgique ?
Le Saint-Siège avait marqué aux nouveaux Bénédictins l’un de leurs principaux devoirs par ces paroles que l’abbé de Solesmes prit pour épigraphe de son livre : Samas pontificii juris et sacra liturgiea traditiones LABASCENTES confavere. ce terrible labascentes n’était que trop exact. La liturgie n’était plus connue dans cette France où les liturgies abondaient. Chaque diocèse avait son rite, et même il est tel diocèse que nous pourrions citer, où s’épanouissaient trois liturgies à la fois : végétation vraiment trop luxuriante ! Quelques églises étaient demeurées fidèles au Missel et au Bréviaire romains : elles passaient pour arriérées. Cette liturgie, qu’on ne connaissait pas, on l’aimait moins encore.
Quelques esprits, d’ailleurs corrects, subissaient leur bréviaire plus qu’ils ne le goûtaient. On consentait à admirer certains rites touchants, poétiques : mais cette admiration à la Chateaubriand n’avait rien de profond ni de substantiel. Quant à trouver une vraie beauté aux collectes et aux postcommunions du Missel, aux antiennes et aux répons du Bréviaire, on en était à mille lieues. On ne comprenait plus, on n’aimait plus la règle, l’expression, le langage du culte catholique. Et ce fut alors que dom Guéranger osa publier le premier tome de ces fameuses Institutions dont le retentissement fut si grand.
La Préface de cet excellent livre en indiqué fort nettement toute l’utilité et en exposait le but. Dès la seconde page, l’ardent apologiste posait la question pratique : « Qu’est devenue, disait-il, cette unité de culte que Pépin et Charlemagne, de concert avec les Pontifes romains, avaient établie dans nos églises ; que nos évêques et nos conciles du XVIe siècle promulguèrent de nouveau avec tant de zèle et de succès ?
Dix Bréviaires et dix Missels se partagent nos églises, et le plus antique de ces livres n’existait pas à l’ouverture du XVIIIe siècle. » Voilà ce qui s’appelle entrer dans le vif d’un problème et prendre généreusement la responsabilité d’une belle et téméraire entreprise. Je ne veux pas aborder ici le récit de tous les orages que soulevèrent ces quelques lignes de l’illustre Bénédictin, que souleva tout son livre. Il est inutile, en plein soleil, en plein calme, en pleine joie, de raconter péniblement les antiques tempêtes ; il est inutile, en temps de paix, de réveiller inutilement les vieilles querelles endormies. Dom Guéranger se contenta de vaincre : il eut trop de modestie pour triompher.
Il nous sera permis de parler plus longuement du plan de ces Institutions liturgiques, et de leur mérite littéraire. L’auteur suit l’ordre chronologique. D’un bond rapide il ne craint pas de s’élancer jusqu’à Jésus-Christ, et de Jésus-Christ jusqu’à Adam. Il montre dans la liturgie originelle l’ébauche de la liturgie mosaïque, et dans celle-ci l’ébauche de la liturgie catholique. Ses doctrines rendent le même son que celles de l’abbé Rohrbacher, qui fut suscité vers le même temps pour élever à tout jamais le ton de l’histoire. L’auteur de l’Histoire de l’Église avait fait voir dans Adam le premier catholique romain : dom Guéranger fait voir dans l’homme originel le premier de tous les liturgistes ; « Dieu daigna lui révéler les formes de la liturgie, comme il lui donna la pensée, comme il lui donna la parole (1). »
Et l’abbé de Solesmes nous fait assister à cet incomparable spectacle du premier homme, les mains tendues vers le ciel, les yeux pleins d’une beauté suppliante, et laissant échapper de ses lèvres le lyrisme impétueux de ses premières prières. La liturgie mosaïque est plus clairement indiquée et analysée dans les Livres : dom Guéranger n’a donc eu qu’à commenter le Lévitique, et à le commenter rapidement. Il a hâte, d’ailleurs, d’en venir au centre vivant du culte universel, à Jésus-Christ, prêtre et victime, dont « la vie n’a été qu’un grand acte liturgique (2), » dont le sacrifice est le fondement ou plutôt l’essence même de la liturgie, et qui, avant de remonter au ciel, a investi officiellement ses apôtres du pouvoir liturgique. Ces admirables doctrines sont exprimées en un style clair, animé, brillant, solide. En lisant ces pages, l’âme et le corps lui-même prennent une attitude plus digne. On sent dans ces premières pages le noble et délicieux parfum de la théologie romaine ; on est fier d’être homme, et d’être chrétien.
Ce n’est pas ici le lieu de résumer toutes les Institutions liturgiques. Une seule pensée, une maîtresse pensée relie entre elles toutes les pages de ce livre, et cette pensée est celle de l’unité liturgique. Un désir ardent de l’unité, une vivante et énergique aspiration se fait chaudement sentir dans toutes les lignes, dans tous les mots de ces trois volumes, que l’on pourrait intituler : Histoire des tendances à l’unité liturgique.
Durant les premiers siècles, il se forme dans l’Orient et dans l’Occident plusieurs centres liturgiques : Jérusalem et Antioche, Alexandrie et Constantinople, d’une part ; et de l’autre, Rome, qui tient lumineusement le premier rang ; puis, enfin, la Gaule et l’Espagne. Personne mieux que Dom Guéranger n’a démontré la profonde ressemblance de tous ces rites, ou la forme seule et variable. Les Mystères sont partout les mêmes, et l’ordre dans lequel se succèdent les différentes parties du Sacrifice est presque toujours identique. Partout des lectures de l’Ancien et du Nouveau Testament sont faites publiquement devant les fidèles qui sont assemblés dans la basilique ; partout l’offrande du pain et du vin s’accomplit pieusement après ces utiles préliminaires ; partout le diacre invite les cœurs à se tenir en haut, et le sacrifice mystique se consomme partout avec les mêmes paroles de consécration, accompagné des mêmes prières universelles pour tous les besoins des vivants et des morts.
L’Église romaine fut dès lors le centre de la liturgie, et les autres prétendues centres s’évanouirent l’un après l’autre. Les Grecs, je le sais, ont gardé leurs rites propres, que les hérétiques de tous les siècles, et surtout les monophysites, ont de plus en plus corrompus ; mais, grâce au génie de Pépin et de Charlemagne, la liturgie romaine fut énergiquement établie dans les Gaules, et grâce au génie de saint Grégoire VII, les rites mozarabiques cédèrent la place aux rites romains sur tout le sol de l’Espagne chrétienne. Pendant plus de cinq cents ans, la liturgie romaine a donc retenti sous les voûtes de nos cathédrales françaises. Elle y subit d’importantes, de nombreuses additions : on l’attifa, on la para de vêtements gracieux, de nouvelles hymnes, de tropes, de proses et d’offices nouveaux, et c’est avec une grande justesse que Dom Guéranger a inventé, pour qualifier ce mélange de rites, le nom de liturgie romano-française ; mais, somme toute, le fond du culte était toujours romain, et c’est ce qui nous permet d’arriver, sans trop de colère contre tant d’innovations, jusqu’à la réformation du Bréviaire et du Missel romains par le pape Saint Pie V.
Nous saluons avec bonheur cette belle tentative d’unification et, si nous ne connaissions pas la triste histoire des deux siècles suivants, nous nous laisserions aller à croire que les brefs de Pie V, de Grégoire XIII et de Clément VIII ont mis fin à tout problème, à toute discussion liturgiques. Hélas ! il n’en fut rien. Alors qu’on pouvait croire tout fini, tout recommença. Un amour étrange pour une verte périlleuse, pour une élégance trop conforme aux règles de la rhétorique, détermina en France, au dix-septième siècle et au dix-huitième siècle, un mouvement regrettable.
De nouvelles liturgies furent partout fabriquées avec je ne sais quelle fièvre de mauvaise indépendance, et les vieux rites romains furent abandonnés aux diocèses rétrogrades. Nous ne voulons pas envenimer ce débat, et nous saurons ne pas nous indigner contre ces nouveautés. Le livre de dom Guéranger est fort complet sur une aussi grave matière : c’est la partie la plus remarquable des Institutions liturgiques. L’auteur est dans le véritable élément de son talent et de son édition : il est vif, il est entraînant, il est spirituel sans cesser d’être savant ; il est savant sans cesser d’être aimable. Il déterre les vieux livres oubliés des docteurs de Sorbonne ; il exhume les dissertations gallicanes et romaines ; il nous fait assister aux escarmouches et aux batailles des liturgistes.
Il ne dédaigne pas l’Art, et réclame pour sa chère romaine le noble privilège de la beauté. Il compare le Bréviaire romain aux autres bréviaires ; il oppose les hymnes aux hymnes, les répons aux répons ; il attaque, il combat, il frappe, il avance, il triomphe. Il est peu de lectures aussi vivantes. Joignez à cela une bibliographie complète de toutes les sciences qu’étudie notre auteur ; une nomenclature fort précieuse de tous les liturgistes qui ont écrit depuis le premier jusqu’au dix-huitième siècle, et l’indication de tous leurs travaux ; une appréciation rapide et saine de toutes ces œuvres ; des résumés clairs ; une philosophie de l’histoire qui rappelle les doctrines de Joseph de Maistre, et ce style plein de sagesse et de fougue qui est l’un des caractères de cette vive intelligence. Bref le livre est excellent, et son influence a été encore plus considérable que son mérite. Dressez plutôt la liste des églises de France qui suivaient la liturgie romaine en 1840, et calculez le nombre des diocèses qui la suivent en 1893 ; puis, tirez la conclusion.
Il ne s’agissait pas seulement de faire connaître la liturgie romaine : il fallait la faire aimer. Les Institutions liturgiques étaient surtout un livre de polémique, et la polémique n’engendre pas l’amour. C’est pourquoi l’abbé de Solesmes, fatigué de ces luttes, et, en quelque sorte pour se reposer, se prit à écrire cette Année liturgique dont nous voudrions exposer le plan avec une lucidité qui en fit souhaiter la lecture. Le grand Bénédictin nous offre pour chaque jour du cycle ecclésiastique l’Office romain magnifiquement élucidé et commenté par lui.
Dans les Institutions, on n’avait admiré, pour ainsi parler, que l’entendement de dom Guéranger ; dans l’Année liturgique, on sent son cœur. Ce cœur se répand en belles et amoureuses effusions pour interpréter chacune des paroles de l’Église romaine. Comme aucune étroitesse n’est possible dans l’esprit vaste et généreux de l’abbé de Solesmes, il a ajouté aux prières de la mère Église celles de toutes les autres Églises de la catholicité. Il nous a fait entendre les voix de toutes les liturgies, voiix qui sont d’accord et forment un beau concert. C’est ainsi qu’après avoir lu l’Année liturgique, le plus humble chrétien connaîtra les plus gros fragments des liturgies grecque, gallicane, mozarabique, ambrosienne ; les plus riches nouveautés que le zèle un peu excessif de nos pères avait jetées en France sur l’austère tissu de la liturgie romaine ; nos plus belles proses nationales, les hymnes du moyen âge qui méritent d’être retenues et d’être aimées ; tout ce que les liturgistes orthodoxes de tous les temps ont jusqu’ici produit de plus parfait.
Notez que ces admirables fragments sont traduits, et que nos femmes et nos filles peuvent se donner la joie de cette lecture, puisqu’elles ont le malheur de n’être pas initiées aux beautés originales de la langue liturgique. Chaque volume est précédé d’une belle Introduction où l’on étudie tour à tour « l’historique, la mystique et la pratique » de toutes les périodes de l’année liturgique. À mesure qu’on lit ces pages simples et ardentes, la lumière se fait. Ceux qui se défient de la liturgie romaine seraient aisément convertis par un demi-volume. Les plus hostiles ne résisteraient point à la lecture du volume tout entier. Encore un coup, ce livre produit l’amour.
Intelligence, comme le cœur, y est éclairée des meilleures clartés. L’ignorance en matière de liturgie est plus grande au milieu de nous qu’on oserait le penser. On ne sait même plus les noms de ces livres liturgiques dont l’Église place les textes vénérés entre les mains de ses enfants. Le symbolisme, est-il besoin de le dire ? n’est plus saisi d’aucune intelligence. Les esprits les mieux disposés n’ont souvent à l’égard des rites sacrés qu’une sorte d’admiration vague et presque honteuse.
C’est cette ignorance qu’il importait de dissiper. Dom Guéranger a appelé à son aide l’histoire et l’archéologie. Il ressuscite avec puissance les cérémonies et les rites des vieux siècles, sans jamais perdre des yeux nos cérémonies et nos rites qu’il s’est proposé de mettre en lumière. Il est tout à la fois archaïque et actuel. Nous pensons avoir déjà confessé plusieurs fois, nous confessons encore aujourd’hui fort volontiers qu’avant de lire l’Année liturgique, nous n’avions point l’intelligence de cet admirable office du Samedi saint, la plus longue et peut-être la plus importante fonction liturgique de toute l’année. Tout à coup une grande lumière s’est faite dans notre esprit : nous avons tout compris, nous avons tout vu. Nous venions de lire les admirables pages que Dom Guéranger a consacrées à cet office dans la Passion et la Semaine sainte.
C’est là qu’il établit, avec une éloquence imagée et savante, que l’office actuel se célébrait autrefois durant la nuit de Pâques, et qu’il a gardé fidèlement toute sa physionomie primitive et jusqu’à ses antiques rubriques. De là les cérémonies du cierge pascal qui éclairait jadis les ténèbres bénies de cette nuit incomparable ; de là les douze lectures qu’on faisait aux heureux catéchumènes, pour qu’ils attendissent avec patience l’instant désiré de leur baptême ; de là cette procession aux fonts qui avait lieu jadis de la basilique au baptistère, et qui conduisait tant de néophytes à l’innocence et à la béatitude sacramentelles ; de là à ce retour des nouveaux baptisés à la basilique illuminée par les premières clartés du jour.
Dom Guéranger a su ressusciter tout ce rituel merveilleux. Il lui a réellement donné la vie. Il nous prend par la main vivement et nous conduit en réalité dans une des basiliques des premiers siècles ; il se place auprès de nous, il nous explique à voix basse tout ce qui se passe sous nos yeux ravis. Et chacun de nous ne peut que s’écrier : « Je sais, je vois, je crois ! »
C’est ainsi que l’abbé de Solesmes a rempli la double mission que Dieu lui avait donnée : « Faire comprendre la liturgie de l’Église romaine ; la faire aimer ». Si tous les esprits, si tous les cœurs ne se sont pas rendus, ils sont disposés à se rendre. Ils voient qu’aux seuls rites de Rome appartiennent ces trois caractères capitaux : l’Antiquité, l’Autorité, l’Unité.
Et quant à ce quatrième caractère essentiel qu’on a contesté à la liturgie des Souverains-Pontifes, quant à la Beauté, l’abbé de Solesmes a, d’une main forte, écarté tous les voiles qui en cachaient le rayonnement. Sa démonstration est complète, et il a pu se reposer dans le triomphe de sa cause. J’aime à croire qu’une de ses récompenses dans le ciel consistera à voir et à entendre sur la terre cette belle unité de prière dont ses travaux auront assuré ici-bas la victoire durable et sans doute immortelle.
Dans le portrait de dom Guéranger, on court risque de se heurter constamment à des questions qui ont soulevé jadis de formidables orages. La vie de l’abbé de Solesmes n’a été qu’une bataille, et, en la racontant, on ne saurait éviter de parler de ses adversaires, qui sont les nôtres. Mais il n’est pas impossible d’en parler avec réserve, et nous venons de lire cette œuvre admirable du P. Faber, la Bonté, qui nous dispose à la douceur et au respect.
Il nous faut nommer tout d’abord le livre de dom Guéranger qui a nécessité de notre part cet exorde insinuant : ce sont les Essais sur le naturalisme contemporain, ou, pour parler plus nettement, les vingt-quatre articles que notre Bénédictin a naguères consacrés dans L’Univers à la réfutation du célèbre ouvrage de M. de Broglie, L’Église et l’Empire romain au quatrième siècle. Je me souviens encore très vivement du retentissement de ces belles pages.
Dom Guéranger a mérité par elles de devenir le modèle de tous ceux à qui l’on confie, dans un journal, la plume du critique. C’est avec ce respect de nos lecteurs, c’est avec ces longs travaux préparatoires, c’est avec cette conscience et ce zèle que nous devons traiter toutes les œuvres que nous analysons. Et plût à Dieu que nous eussions la même érudition, le même sens critique, le même style ! Nous n’ignorons pas cependant qu’on a violemment accusé dom Guéranger d’avoir alors manqué de ménagements à l’égard d’un des plus illustres catholiques de France ; mais c’est en vain que nous avons cherché dans les cinq cents pages de ce beau livre un seul mot dont le son fût dur, une seule note âpre, une seule injustice, une seule injure : nous n’avons rien trouvé de tel.
On nous avait fait craindre un critique amer dans sa sincérité et inopportun dans son zèle : nous n’avons rencontré qu’un père à cheveux blancs, grondant d’un ton fort doux un fils fort tendrement aimé. En vérité, cette critique n’est qu’une forme de la charité.
Quelle fut le véritable objet de cette célèbre polémique entre l’abbé de Solesmes et le jeune historien de l’Église et l’Empire romain au quatrième siècle ? Laissons de côté les questions secondaires : andiamo al fondo.
En déblayant le terrain, en écartant les inutilités, voici le problème, le riz problème qu’il s’agissait de résoudre : « Quelles ont été, dans l’établissement du christianisme, la part de l’homme et la part de Dieu ? » Donnons tour à tour la parole aux deux écoles, et faisons-les parler sans partialité, sans prévention, comme elles auraient parlé elles-mêmes.
« Je m’incline devant le Surnaturel, dit l’école de M. de Broglie dont la bonne foi ne saurait être suspecte. Le Surnaturel, que je ne veux pas confondre avec la Providence, ce n’est pas l’intervention de Dieu dans les choses ordinaires de la vie et de l’histoire : c’est son intervention en dehors des lois naturelles, c’est son intervention en des faits d’un ordre supérieur à l’ordre de la nature.
Dieu nous procure le moyen de soutenir la vie terrestre de nos enfants : c’est la Providence ; il ressuscite un de nos enfants morts : c’est le Surnaturel. Le Miracle est un des noms du Surnaturel ; c’est peut-être son nom le meilleur et qui est le plus facile à comprendre. Nous ne nions pas la grande part que le miracle a prise à la conversion de l’ancien monde ; mais nous pensons que cette conversion trouve aussi son explication dans les faits de l’ordre naturel. N’est-il pas certain, par exemple, qu’au moment où a éclaté dans l’Empire romain la prédication des Apôtres, il y avait, dans toutes les intelligences d’élite, de profondes et énergiques aspirations vers une meilleure doctrine, vers un dogme plus spiritualiste, plus épuré ? Le christianisme a donné satisfaction à ces désirs, qui étaient en même temps très naturels et très légitimes. N’est-il pas vrai que la morale chrétienne, par sa beauté poétique, a dû entraîner les imaginations et les cœurs ?
N’était-t-on pas dégoûté de l’idolâtrie et du polythéisme ? N’était-t-on pas las de l’orgie ? Ne devait-il pas enfin se produire une réaction très naturelle, qui a précipité heureusement des milliers d’âmes dans la pureté des nouvelles doctrines ? Ne me parlez donc pas avec tant d’opiniâtreté des miracles qui ont signalé les premiers siècles de l’Église : nous n’en avons pas besoin. Avec le cœur humain tout seul nous expliquons la fin du paganisme et le triomphe de Jésus-Christ. Vous nous dîtes que les apôtres ont été foudroyés par la grâce et qu’ils ont frappé le monde, qu’ils l’ont converti de même à coups de foudre, à coups de grâce. Nous le voulons bien ; mais, dans l’apôtre, ne me supprimez pas l’homme. N’allez pas surtout donner à tous ces prédicateurs de la grande doctrine la même physionomie, que vous rendriez monotone à force de la surnaturaliser.
Saint Paul ne ressemble pas à saint Pierre, et saint Jean ne leur ressemble point. Saint Pierre au sein du Collège apostolique, représente l’élément judaïque ; saint Paul y représente les espoirs et les tendances de la gentilité ; saint Jean, c’est l’amour qui, après la mort de saint Pierre, exerça dans l’Église une véritable et noble suprématie. Laissez, laissez leur traits naturels à ceux qui ont eu une mission surnaturelle. N’étouffez pas la nature, respectez-la, et confessez que, dans la formation de la société chrétienne, elle a rempli un grand rôle à côté du Surnaturel devant lequel nous sommes à genoux.
-« Vos doctrines, répond la seconde école, sont étrangement dangereuses : elles me donnent presque de l’effroi ; j’ai peur. À force de ne pas vouloir écraser la nature, vous la divinisez. Vous prétendez qu’il y avait dans tout l’Empire une immense aspiration vers le christianisme, et qu’il devait être accueilli avec de Ah! d’enthousiasme et de désir satisfait. Toute l’histoire proteste contre une telle hypothèse. À part quelques âmes de choix dont on ferait aisément le compte, le christianisme fut reçu par des huées, par des cris de rage, par de sanglantes et horribles menaces. Cette religion qui répondait si parfaitement aux besoins de notre nature, on a voulu la noyer pendant trois siècles dans le sang heureusement fécond de ses sectateurs honnis et déshonorés. Douze ou quinze millions de martyrs attestent avec quel succès se produisit un dogme si conforme, suivant vous, aux soupirs des intelligences et aux battements de cœur.
Le Musée Sacré, à Rome, où l’on conserve les augustes instruments du supplice des martyrs, nous fait voir aussi, et non sans éloquence, comment la nouvelle morale avait conquis les sympathies universelles. Vous prétendez que, par une salutaire et naturelle réaction, cette morale devait aisément triompher dans le monde. Ici encore le miracle n’aurait été, d’après votre système, que d’une utilité secondaire, et il n’était pas absolument nécessaire, selon vous, de foudroyer les âmes par les coups inattendus de la grâce, de ressusciter les morts, de rendre la vue aux aveugles et la parole aux muets.
Non, le monde ancien, dites-vous, avait soif et faim d’une morale pure et élevée, et à peine a-t-il aperçu l’Église qu’il s’est jeté dans ses bras. Voilà ce que vous prétendez, et je ne pense pas avoir exagéré vos doctrines. Cependant, si j’ouvre l’histoire, je ne trouve guère dans l’empire romain, à l’époque de sa décadence, que vices monstrueux et concupiscences inassouvies. J’y vois des débauchés qui sont heureux de l’être et qui veulent l’être davantage encore. Dans les hautes classes, ce sont des orgies délicatement ignobles ; dans le peuple, ce sont des orgies brutales. Les plébéiens aiment les distributions de mangeaille et les tueries du cirque ; les patriciens aiment les dîners qui coûtent des milliers de sesterces. Les uns et les autres détestent la doctrine chrétienne, qui leur ordonne de jeûner.
Ceux qui recommandent le jeûne, sachez-le bien, ne sont jamais bien accueillis par ceux qui se donnent tous les jours de coupables et monstrueuses indigestions, et tel était le cas des Romains aus premiers siècles de l’Église. Eh ! transportez-vous de nos jours dans quelqu’un de nos infâmes petits théâtres, en présence de ce public où abondent les incrédules élégants, les filles de mauvaise vie, les escrocs, les viveurs : montez sur une borne, et prêchez l’abstinence à ces gens qui sablent du champagne : soyez certains que les aspirations de leurs âmes et les besoins de leurs intelligences ne seront nullement d’accord avec vos beaux discours, et que vous serez sifflé.
Encore un coup, je vous accorde que deux ou trois belles âmes pourront être redressées par votre morale élevée ; mais la grande majorité restera dans sa fange, il faudra que d’énergiques courants de la grâce traversent cette société à moitié morte pour lui rendre la vie et la transfigurer. Le Surnaturel est nécessaire contre une telle nature, et Dieu a employé le Surnaturel. N’allez pas surtout appliquer votre système naturaliste à la physionomie de nos apôtres. Rien n’est plus dangereux, rien n’est plus faux que de s’écrier : « Saint Paul, c’est la gentilité ; saint Pierre, c’est le judaïsme ; saint Jean, c’est l’amour. » Avec des textes qu’il serait facile de multiplier, dom Guéranger a fait justice de ces prétentions romanesques et romantiques ; il a montré saint Paul aussi judaïque que saint Pierre, saint Pierre aussi aimant que saint Jean.
Les théories de nos adversaires ne sont-elles pas d’ailleurs trop voisines de celles de M. Taine, qui donne une si large part dans l’histoire au climat, au moment, au milieu, au tempérament ? Ne peut-on pas, sans tomber dans cet excès, laisser à la nature une belle et légitime place ? Ne peut-on pas, sans aller aussi loin que les naturalistes, laisser sa physionomie propre à chacun des ouvriers de la vigne céleste ? Nous ne sommes aucunement éloignés de le penser. In medio virtus et veritas. »
Nous venons d’exposer les doctrines des deux écoles que le livre de dom Guéranger a mises en présence : nous nous sentons ici le devoir de nous prononcer en faveur de l’une d’elles, et nous nous rangeons très loyalement au sentiment de l’abbé de Solesmes.
La troisième œuvre du célèbre Bénédictin a consisté dans cette apologie constante des doctrines romaines qui éclate dans tous ses livres. On se rappelle l’émoi que produisit dans le monde chrétien la publication, en 1837, des Origines de l’Église romaine. Les politiques eux-mêmes prirent l’alarme, et la voix de M. Isambert se fit entendre. C’est un ramas d’apocryphes, s’écria-t-il alors à la tribune de la Chambre des députés. Il y eut de nombreuses et virulentes attaques. Nous ne regrettons pas cette explosion ; il vaut mieux qu’on se passionne pour ou contre une grande doctrine que de demeurer dans l’inertie honteuse d’une indifférence plus ou moins sincère.
Dom Guéranger, d’ailleurs, n’était pas embarrassé de répondre à ses adversaires. La question était belle : il s’agissait de savoir à quelles sources était puisé le Liber pontificalis, ce document qui jette une si vive et si pure lumière sur l’histoire des premiers papas. Est-il l’œuvre originale d’Anastase le bibliothécaire ? Ou n’est-il pas plus probable qu’Anastase aura seulement compilé les notes que ses prédécesseurs rédigeaient tour à tour sur les pontificats dont ils étaient les contemporains ?
Tel est le problème que nous n’avons pas ici à résoudre et que dom Guéranger discute avec une force lucide. Plusieurs chapitres de son livre forment des opuscules complets que l’excellent livre de l’abbé Duchesne ne jettera pas dans l’ombre. Nous signalons surtout ceux qui ont pour objet les notaires de l’Église romaine durant les premiers siècles. Tous ceux qui s’occupent de Diplomatique pontificale devront consulter ces pages savantes, claires, décisives.
Que l’abbé de Solesmes ait combattu pour l’idée romaine en liturgie, c’est ce que nous avons surabondamment démontré. Qu’il ait été le soutien des mêmes doctrines dans sa lutte contre le naturalisme contemporain, c’est ce que confessera tout esprit impartial. Mais, en vérité, toute cette intelligence était un aimant tourné vers Rome. Veut-il écrire la vie d’un saint, il choisit une des vierges les plus chères à l’Église romaine, et se consacre à sainte Cécile.
Dans son Mémoire sur l’Immaculée Conception de la Vierge, il donne une voix aux soupirs de l’Église universelle et prépare le travail du Saint-Siège. Toutefois, son amour pour les principes de Rome ne s’est jamais manifesté plus originalement, plus vivement que dans la longue série de ces articles sur Marie d’Agréda. Il est bien entendu que nous n’avons aucune autorité pour traiter ici de la question de la Cité mystique, question si profondément controversée depuis plus de deux cents ans. Nous préférons constater scientifiquement que dom Guéranger a profité de ses études sur la vénérable abbesse pour tracer la physionomie de l’époque tout entière où l’on discuta pour la première fois ses révélations et ses doctrines. Il nous ouvre la porte de la Sorbonne à la fin du XVIIe siècle, il nous y introduit avec lui, il nous y fait assister aux menées gallicanes et aux intrigues jansénistes ; mais surtout il nous fait toucher du doigt les grandes plaies de ce temps que certains méprisent injustement, mais que d’autres ont peut-être vanté à l’excès. La fin du « grand siècle » fut triste : on est effrayé des germes d’incrédulité, de révolte, d’athéismes qui déjà sont visibles partout.
Le XVIIIe siècle est tout entier contenu dans la fin du siècle précédent ; la Révolution semble avoir commencé. Dom Guéranger nous a dénoncé ce grand fait en nous montrant les allures indépendantes et en ouvrant nos oreilles au libre parler des libres penseurs de 1690. Il nous a par là rendu un grand service. On suppose de par le monde que nous sommes les admirateurs exclusifs de Louis XIV et de son temps. Nous ne voulons pas plus parquer notre admiration dans ce siècle que dans un autre.
Un siècle est trop étroit pour contenir les enthousiasmes d’un chrétien, même ses enthousiasmes politiques. L’absolutisme sans bornes de Louis XIV nous scandalise ; sa prétention de dominer l’Église nous indigne ; il n’est pas et ne saurait être pour nous le type du roi chrétien, et il nous est impossible, pour tout dire, d’admirer sans réserve une politique qui a tant travaillé à la tyrannie de l’État et la dépression de l’Église.
Il ne nous reste plus qu’à parler de la part glorieuse que prit le grand Bénédictin au concile du Vatican.
Il se passa alors un fait des plus étranges et que les historiens des doctrines religieuses devront un jour mettre en lumière. Un certain nombre de « libéraux », qui avaient débuté par aimer passionnément Rome et les doctrines romaines, tournèrent peu à peu à ce gallicanisme dont ils avaient jadis abhorré l’étroitesse. Ils se firent gallicans, chose étrange, par excès de libéralisme. Le mécontentement et la méchante humeur où ils étaient de voir Rome se prononcer contre eux, les poussa à revenir aux propositions de 1682, et, de fait, ils y revinrent.
Lorsque s’ouvrit le Concile du Vatican, leurs journaux nous surprirent par la vivacité de leur gallicanisme. Tous les arguments de Bossuet furent alors remis en circulation. Nous eûmes la douleur de voir de grands, de généraux catholiques, chercher d’une main jalouse, dans toute l’histoire de l’Église, les pages où l’on pourrait assister à de prétendues défaillances de la sainte Église romaine. Ils mirent autant d’ardeur à chercher ces scandales prendre un de perles à découvrir les trésors cachés de l’Océan.
On n’entendait plus, de toutes parts, que ces mots d’où la passion n’était pas toujours absente : « Tel pape s’est trompé en telle circonstance, en telle année. Honorius a été hérétique. Vigile a été hérétique. Libère a été hérétique. » Une plus rude épreuve nous était réservée. L’École de nos adversaires eut alors pour chef un saint prêtre, au vaste cœur et au large entendement, et qui avait eu sur la jeunesse de nos écoles une action vraiment providentielle. Le P. Gratry écrivit alors ces fameuses Lettres qui troublèrent tant d’esprits. Il se fit un grand silence, et l’on se tourna vers Solesmes.
La Monarchie pontificale répondit à cette attente universelle, et Dom Guéranger y affirma de nouveau l’Unité romaine. Son principal honneur et le résumé de sa vie sont là : il a aimé l’Unité et l’a fait aimer. On ne saurait s’imaginer une érudition plus puissante sous une forme plus modérée. Des faits, des dates, des textes. Et puis encore des textes, des dates, des faits.
Cette tranquillité sûre d’elle-même, cette sérénité triomphante fut d’un heureux augure. Les bons livres abondèrent, et l’argumentation ultramontaine devint de plus en plus serrée. Les Papes furent vengés ; Libère, Vigile et Honorius furent lumineusement justifiées ; l’infaillibilité fut démontrée par la science avant d’être proclamée par l’autorité. Dom Guéranger fit aux catholiques comme un merveilleux escalier qui leur permit de remonter aisément depuis le temps présent jusqu’au premier siècle de l’Église, et chacun des degrés de cet admirable scala était un texte en faveur de l’infaillibilité romaine. On sait le reste ; on sait comment tous les catholiques se soumirent au décret du Concile et quelle mort admirable fit le très regretté Père Gratry.
Nous nous persuadons que la Monarchie pontificale ne fut pas étrangère à ce dénouement, et que ces deux grandes âmes sont réunies là-haut aux pieds de Dieu, pour s’y entretenir éternellement de l’Infaillibilité victorieuse.
Tel fut le dernier combat de Dom Guéranger ; telle fut sa dernière victoire.